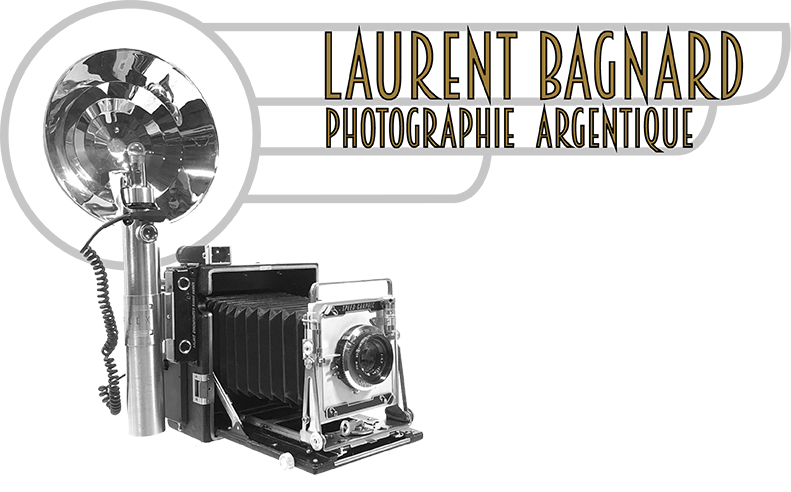
Un peu d’histoire et une déclaration d’intention !
« Photographie argentique » est un terme générique qui prétend en notre époque s’opposer à celui de « photographie numérique ». Le petit vent de nostalgie qui souffle sur le monde de la photo remet au goût du jour un procédé fondamental : celui d’exposer depuis une chambre obscure des ‘sels d’argent’ à la lumière. Le truchement combiné d’un objectif et d’un obturateur décide de la qualité et de la quantité de ce qui va impressionner l’émulsion (terme lui aussi générique), la taille et la sensibilité de cette dernière permettant d’anticiper la précision et l’utilisation des clichés effectués. Ceux-ci ne peuvent être disponibles, par ailleurs, sans l’étape essentielle de leur développement : la photographie argentique implique de savoir prendre son temps !
Chambre 4×5, négatifs et ferrotypes
Les procédés argentiques sont nombreux, de même que ses formats, supports et appareils ! Nous en retiendrons deux sur ce site et dans la pratique. Le premier est en relation avec ce que l’on appelle une chambre photographique, ou encore un appareil ‘grand format’, comme celui de l’illustration de cet article, un Graflex Speed Graphic de 1953.
Pourquoi ‘grand format’ ? Parce que la taille du support de l’émulsion est dans notre cas de 4×5 pouces (10×12 cm environ) : plus le support est grand, plus l’émulsion correspondante est en mesure de conserver les détails de l’image transmise par l’objectif. En 1953, le support était en celluloïd : un morceau de plastique enduit d’une formule sensible à la lumière destiné à fournir un négatif de haute qualité, ou de haute résolution comme on dirait de nos jours pour parler de netteté.
Le négatif 4×5 tend vers cette netteté que les appareils numériques n’ont toujours pas réussi à dépasser ! De même, les supports antérieurs sur plaque de verre (négatif) ou de fer blanc (positif), enduits d’une formule datant du milieu 1800 donnent des résultats stupéfiants… A l’époque où la pratique de la photographie tenait presque de l’alchimie, tous les appareils étaient des chambres photographiques et on fabriquait support et émulsion (ainsi que les bains de développement) chez soi. Le support métallique, le ferrotype, permettait d’avoir rapidement un positif à disposition. Cette technique permit aux premiers photojournalistes de documenter la guerre de Sécession (1861-1865) :
Le Graflex Speed Graphic est en capacité de produire des négatifs tout comme des ferrotypes, donc de faire des photos de différentes époques, impossibles à fabriquer avec un appareil moderne !
Reflex 35mm
Le 35 mm est le terme générique désignant le format ‘pellicule’ le plus courant : il définit la largeur de la pellicule qui fournit des négatifs de 24×36 mm (généralement 36 par rouleau). Sa résolution est donc moindre que celle de la chambre évoquée ci-dessus, et cependant toujours au coude à coude avec celle des appareils numériques professionnels ! Pourquoi ? Comment ? Pour répondre simplement, la qualité des émulsions modernes alliée aux performances des objectifs haut de gamme (‘prime lens’ en anglais) permet depuis les années 60 de produire… quasiment toutes les images fixes que notre conscience collective a sélectionnées depuis lors !
Le reflex 35mm, et plus particulièrement le Nikon F2 – mon choix en la matière – a contribué à édifier notre système d’appréciation de l’image photographique, en noir et blanc comme en couleurs ! Sa maniabilité, sa vitesse et sa robustesse ont porté ce modèle sur tous les fronts de l’actualité des seventies, habituant notre regard à cette particularité argentique : le grain ! L’aspect plus ou moins granuleux du 35mm caractérise la photographie d’avant l’ère numérique et retrouve un regain d’intérêt en cette époque plus productrice d’images que jamais auparavant ! La démarche d’utiliser cette technique s’explique par l’appréciation du facteur temps évoqué plus avant : bien que disposant d’un magasin de 36 vues, aucune d’elle ne doit être prise au hasard. Toutes exigent une concentration dont le numérique et ses automatismes sont à même de dispenser.
Avec un 35mm, la photo ne s’improvise pas !
Elle ne se présente pas non plus sur un petit écran de prévisualisation, et de fait oblige à une confiance en ses capacités – et son matériel – qui est en rapport direct avec la qualité du résultat final ! On sait au moment du déclenchement, voire juste avant, que la photo qui vient d’être emmagasinée est bonne – ou non !
Quant au résultat final, à l’aune duquel on juge la pertinence de la prise de vue, il est simple (enfin !) d’expliquer la différence entre l’argentique et le numérique en opposant ‘sels d’argent’ à ‘pixels’ : l’un est plus ou moins ovoïde, l’autre est carré. L’un est tangible, l’autre virtuel. L’un est organique, l’autre mathématiquement précis.
